La végétalisation et le verdissement en milieu urbain présentent de nombreux avantages pour lutter contre les îlots de chaleur. En plus des aspects esthétiques et fonctionnels indéniables, la présence de végétation permet d’améliorer la qualité de l’air (en produisant de l’oxygène et en captant davantage de CO2), mais aussi d’augmenter la perméabilité des sols, de mieux contrôler l’érosion et de produire des effets bénéfiques sur la santé de la population (protection contre les rayons UV, réduction du stress, etc.).
Les mesures de verdissement peuvent par ailleurs viser une meilleure gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Cela permet de lutter contre les îlots de chaleur et occasionne ainsi, en plus d’une conservation plus importante du taux d’humidité dans le sol, une évapotranspiration supérieure capable de réduire les températures locales.

La végétalisation peut s’effectuer par une politique de verdissement simple permettant la création d’îlots de fraîcheur. Les municipalités peuvent appliquer de nombreuses mesures, parmi lesquelles :
- Augmentation de la plantation d’arbres (programme de plantation, de foresterie urbaine) - découvrez le projet de verdissement participatif de Charlevoix;
- Plantation de mini forêts urbaines naturelles selon la méthode du botaniste japonais Miyawaki - découvrez le mouvement mondial et les deux premières microforêts à Rosemont – La Petite-Patrie
- Végétalisation des secteurs déficients (cours d’école, stationnement, zone industrielle, etc.) - découvrez l'étude de cas de la Ville de Beloeil;
- Protection des secteurs sensibles - découvrez l'étude de cas du marais filtrant de Rosemère;
- Restauration des milieux naturels;
- Végétalisation du pourtour des bâtiments et des marges de recul;
- Utilisation de matériaux plus perméables;
- Etc.
Constats
Les mesures de végétalisation et de gestion des eaux pluviales répondent à la nécessité de conserver et de densifier les milieux végétalisés dans les villes. L’objectif est de lutter contre la perte du couvert végétal en partie responsable du phénomène des îlots de chaleur et des importants problèmes d’infiltration, et donc, de ruissellement dans les milieux urbains.
Pour en savoir plus sur les mesures de végétalisation et de gestion des eaux pluviales :
Outils d'urbanisme et règlementation
Subventions et incitatifs financiers
Communication et sensibilisation
Outils d'urbanisme et règlementation
Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
Élaboré par les municipalités, il peut accompagner le plan d’urbanisme (PU) pour préciser les objectifs d’aménagement de certains secteurs à développer ou à réhabiliter, dans lesquels l’implantation de mesures de verdissement et de gestion des eaux pluviales est nécessaire.
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Les objectifs et les critères émis par le règlement de zonage se répercutent sur le PIIA pour encadrer les mesures de verdissement aux politiques d’ensemble. Les objectifs d’un PIIA tiennent compte des caractéristiques spécifiques des milieux construits et naturels en encadrant les développements par la possible exigence d’aménagements, de verdissement, de toit vert ou encore de mesures de gestion écologique des eaux pluviales.
Les règlements municipaux d’urbanisme (zonage, lotissement, construction)
Ces règlements sont des instruments techniques et juridiques inclus dans le plan d’urbanisme (PU). Ils permettent aux municipalités d’agir de manière très précise en obligeant tous les citoyens à se conformer aux orientations choisies pour son territoire. Ils peuvent par exemple imposer aux nouveaux projets de constructions et à ceux de rénovations (résidentielles, commerciales et institutionnelles) d’intégrer un minimum d’espaces de verdissement (pourtours des bâtiments, cours, stationnements, toits) ou encore à définir une politique de plantation d’arbres. Toute modification d’une ou de plusieurs des trois sections (zonage, lotissement et construction) de la règlementation municipale doit être soumise à une consultation publique.
Étude de cas
Depuis 2011, l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie de la ville de Montréal a adopté de nombreuses mesures pour lutter contre les îlots de chaleur. Il a ainsi développé des environnements plus agréables, plus propres et plus sécuritaires, mais aussi amélioré la qualité de vie de ses citoyens. À l’aide de nouveaux règlements d’urbanisme, l’arrondissement souhaite réduire le plus d’espaces asphaltés ou bétonnés possible pour accroître la végétalisation des lieux publics et privés, mais également soutenir l’agriculture urbaine et l’implantation de toits verts.
Voici divers éléments de leur politique de verdissement :
- Projets de construction ou de rénovation comprenant un pourcentage minimum d’espaces végétalisés;
- Programme de plantation d’arbres au sein des parcs, des secteurs résidentiels et industriels;
- Encouragement l’aménagement de nouvelles ruelles vertes
- Création des jardins communautaires et des projets porteurs (poulailler) valorisant l’agriculture urbaine;
- Augmentation de l’implication de la part les citoyens.
Dans sa lutte contre les îlots de chaleur, l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie légifère également sur divers éléments :
- Interdiction d’installer des surfaces en bitume pour les nouvelles constructions dans le secteur résidentiel;
- Obligation pour les stationnements (commerciaux, institutionnels ou industriels) de plus de dix emplacements d’être aménagés avec une étendue végétale correspondant à un certain minimum de leur superficie totale;
- Obligation pour le revêtement de se composer de béton ou de gravier de couleur pâle (avoir un indice de réflectivité solaire [IRS] d’au moins 29) et d’être perméable (pavé alvéolé) pour permettre une meilleure absorption de l'eau.
Subventions et incitatifs financiers
Pour davantage d’efficacité, les mesures entreprises par les municipalités doivent parfois être temporairement accompagnées de subventions ou de propositions incitatives, en fonction de certains critères précis (durée, montant, cibles, etc.). Ainsi, les municipalités peuvent par exemple prendre en charge une partie des frais rattachés aux aménagements (travaux, matériaux, végétaux) suggérés ou exigés par un programme de subvention, offrir un remboursement équivalent à un pourcentage de la taxe, délivrer gratuitement ou rembourser un permis de construction, etc.
Avantages
Proposer des subventions et des incitatifs financiers permet aux municipalités de démontrer leur engagement auprès des différents acteurs concernés dans l’application des nouvelles mesures. Plusieurs solutions d’aides peuvent être présentées pour répondre à la variété des besoins et donc, réussir à intéresser plus de personnes.
À prendre en compte
Les municipalités doivent établir un budget pour subventionner les mesures, qui doit être validé par le conseil municipal et adapté aux objectifs souhaités. Dans le cas de mesures incitatives, de gratuité ou de remboursement de permis de construction, elles doivent prendre en considération l’absence d’une source de revenus. Afin de gagner en efficacité, les subventions et mesures incitatives doivent avoir une durée limitée pour être plus facilement réajustées, prolongées ou arrêtées en fonction de leur succès.
Étude de cas
La ville de Laval a mis en place deux programmes pour la plantation et l’entretien des arbres, favorisant le verdissement :
- Le programme de don d'arbres accorde jusqu'à 10 arbres gratuits par adresse. La distribution se fait deux fois par an, et il y a possibilité de choisir parmi plusieurs essences d’arbres. La priorité des dons d'arbres est allouée aux personnes résidant dans des îlots de chaleur.
- Le programme de subvention, lui, rembourse 75 % de vos frais pour planter un arbre, jusqu’à un maximum de 200 $ et de 10 arbres par adresse. Le choix de l’arbre doit être fait selon une liste préétablie par la municipalité et il doit respecter un critère de grandeur. Pour être admissible, la plantation doit être faite entre le 1er avril et le 30 novembre de l’année de la demande.
Les citoyens peuvent soumettre leur demande depuis le site internet de la ville.
Communication et sensibilisation
Le choix et la mise en application des mesures de verdissement à l’aide d’outils et de modifications règlementaires nécessitent au préalable d’informer les acteurs concernés. Il faut les éclairer sur les causes et les conséquences des îlots de chaleur urbains en insistant sur leurs impacts négatifs, mais en n’oubliant pas de mentionner en quoi la décision d’appliquer des mesures spécifiques permet d’engendrer de nombreux bienfaits pour la communauté.
Pour cela, elles peuvent, entre autres :
- Proposer un programme d’information incitant les citoyens au verdissement des murs (plantes grimpantes), des toits (toit vert) et à la mise en place de jardins communautaires;
- Organiser des séances d’informations publiques sur le sujet;
- Mettre à jour son site internet avec les nouvelles informations sur les mesures et proposer de l’information sur les réseaux sociaux;
- Élaborer et distribuer un pamphlet informatif;
- Définir des objectifs chiffrés pour une plus grande adhésion de la population;
- Établir par un communiqué un bilan détaillé des résultats des mesures;
- Faire des campagnes de sensibilisation bénévoles;
- Publier des informations sur les mesures dans le journal local;
- Etc.
Avantages
Une campagne d’information et de sensibilisation est essentielle pour faire connaitre les raisons et les objectifs des mesures proposées. Elle permet d’intéresser, et donc d’impliquer, les citoyens autour de projets visant l’amélioration de la collectivité, mais surtout de les mettre en place plus efficacement.
À prendre en compte
Les informations destinées à tous les acteurs concernés par les mesures de verdissement doivent avoir un impact important. Il est donc nécessaire que la communication proposée présente les enjeux en lien avec la mesure de manière accessible, en n’omettant pas d’établir le contexte et les raisons qui conduisent à prendre ces initiatives. Le plan d’action et l’échéancier de certaines réalisations doivent faire partie de l’information transmise.
Étude de cas
Dans sa lutte contre les îlots de chaleur, la ville de Gatineau met à disposition de ses citoyens, sur son site internet, de l’information concernant les causes et les conséquences du phénomène des îlots de chaleur, ainsi que les mesures envisageables pour lutter contre leurs effets.
Elle en profite également pour mettre de l’avant ses projets en lien avec le verdissement de la ville, tel que le verdissement de la rue Eddy, ayant eu lieu il y a quelques années. Le site internet de la municipalité proposait une page complète concernant le projet de verdissement de cette rue commerciale et résidentielle du centre-ville, sujette au manque d’espaces verts et à la prolifération de surfaces asphaltées ou bétonnées.
La page expliquait la problématique générale et les mesures proposées, en insistant davantage sur les étapes de réalisations et l’implication des différents acteurs. Elle illustrait, par exemple les premières réalisations ou les concertations ayant eu lieu. Grâce à cette page internet, la municipalité mettait en application la majeure partie de sa campagne d’information et de sensibilisation. Elle proposait aux citoyens de s’impliquer, entre autres, par une participation à des concours (plus beau bac, meilleure photo), des ateliers (tricot urbain, horticulture) ou des évènements promotionnels. Ils pouvaient également s’exprimer sur le projet par l’intermédiaire d’une page Facebook. La démarche municipale était très détaillée et indiquait, outre les échéances importantes à venir, les partenaires du projet et son financement.






















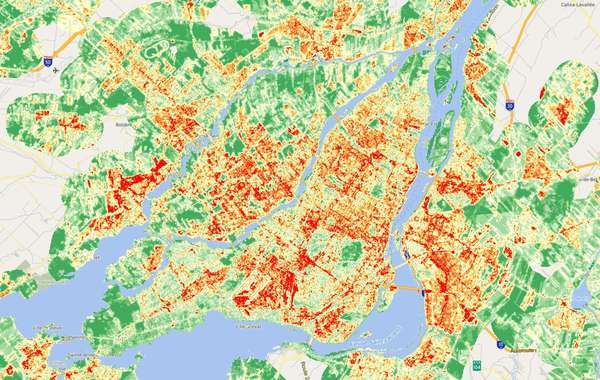




Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter